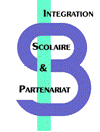nous écrire
|
Adresse de cette page : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page203.htm | ||||||||
Mise
à jour | ||||||||
| ||||||||
 M. François FILLON Premier ministre | ||||||||
|
modifiant
l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le
guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités
des personnes handicapées. J.O n° 259 du 8 novembre 2007 page 18295 - texte n° 20 NOR : MTSA0756880D | ||||||||
On
trouve ce décret sur le site : | ||||||||
è Nous présentons ce texte page Présentation du décret Extraits Article 1 | ||||||||
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles établissant le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est modifiée comme suit : | ||||||||
I.
- Avant le chapitre Ier, il est inséré une introduction générale
dont le texte figure en annexe 1. | ||||||||
Fait
à Paris, le 6 novembre 2007. | ||||||||
ANNEXE 1 : Introduction générale au guide-barème Le
présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination
d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable
en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel
que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des
familles (…). | ||||||||
| Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. | ||||||||
| La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : | ||||||||
| Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. | ||||||||
| Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, | ||||||||
| Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement. | ||||||||
| Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre (…). De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. | ||||||||
| En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en oeuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. | ||||||||
| Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. | ||||||||
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences : | ||||||||
| I.
- Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales. VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur. VIII. - Déficiences esthétiques. |
||||||||
| Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : | ||||||||
-
forme légère : taux de 1 à 15 % ; |
||||||||
| Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. | ||||||||
| Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. (…)Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. | ||||||||
| Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. (…).. | ||||||||
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : | ||||||||
-
se comporter de façon logique et sensée ; | ||||||||
| Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. | ||||||||
| (...) Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. | ||||||||
| Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. | ||||||||
ANNEXE 2 : Chapitre VI - Déficiences viscérales et générales Introduction Pour ce chapitre plus particulièrement, il convient de rappeler que l'évaluation des taux d'incapacité est fondée sur l'importance des déficiences, incapacités fonctionnelles et désavantages en découlant, subis par la personne, et non seulement sur la nature des affections médicales dont elle est atteinte. | ||||||||
| (…) Concernant les enfants et adolescents, il convient de tenir compte également des contraintes assumées par l'entourage familial, pour préserver au maximum la présence de l'enfant dans son milieu de vie naturel (…). | ||||||||
| (…) En fonction de leur importance, les conséquences des déficiences viscérales et générales peuvent être évaluées selon une échelle divisée en quatre classes, réparties de la manière suivante : | ||||||||
| 1. Troubles légers entraînant une gêne, (…) sans incapacité réelle dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne. | ||||||||
| 2. Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle, permettant cependant le maintien de l'autonomie et de l'insertion du sujet dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne. | ||||||||
| 3. Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne, qui se trouve alors limitée au logement ou à l'environnement immédiat ou nécessite des aides ou efforts particuliers pour maintenir une vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée sans effort majeur pour les actions relevant de l'autonomie individuelle telles que définies dans l'introduction du présent guide-barème. Ce niveau de troubles définit l'obtention d'un taux au moins égal à 50 %. | ||||||||
4.
Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie
individuelle. Le seuil de 80 % est ainsi atteint. Section 1 - Les déficiences viscérales et générales | ||||||||
| I.
- Déficiences des fonctions cardio-respiratoires (…) II. - Déficiences de la fonction de digestion (…) III. - Déficiences de la fonction hépatique (…) IV. - Déficiences des fonctions rénales et urinaires (…) V. - Déficiences d'origine endocrinienne, métabolique et enzymatique (…) VI. - Déficiences des fonctions immuno-hématologiques (…) | ||||||||
Les
désavantages cités dans ce chapitre procèdent des incapacités
et des contraintes, mais peuvent être majorés par certains symptômes
ou des effets secondaires des traitements, qui sont à prendre en compte
dès lors qu'ils évoluent au long cours. | ||||||||
| I.
- Symptômes à rechercher, susceptibles d'entraîner ou de majorer
des incapacités et désavantages Enumérés de façon non exhaustive dans cette section, les symptômes doivent être recherchés soigneusement, afin de mesurer leur impact. | ||||||||
Ils résultent de l'affection causale ou sont induits par les traitements et sont susceptibles d'aggraver l'entrave à la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne, par exemple : (…) II. - Les incapacités Les déficiences viscérales et générales peuvent occasionner des incapacités de toutes sortes. | ||||||||
(…) Dans ce chapitre, on portera une attention particulière mais non exclusive à trois types d'incapacité les plus fréquents : | ||||||||
| II-1.
Incapacités concernant la locomotion (…) II-2. Incapacités concernant les soins corporels (…) II-3. Incapacités révélées par certaines situations | ||||||||
Elles sont liées à l'affection causale elle-même ou à la nécessité d'un traitement qui peut être curatif ou n'agir que sur la compensation de la déficience. Ce qui en fait un élément constitutif de handicap est en général la nécessité de maintenir cette contrainte de manière prolongée, nécessitant des réaménagements parfois majeurs de la vie de la personne et susceptibles d'entraver gravement son insertion sociale et son indépendance personnelle. (…) IV. - Situation des enfants ou adolescents (…) Il conviendra donc d'être particulièrement attentif pour eux aux éléments suivants : | ||||||||
-
contraintes supplémentaires liées aux déficiences, incapacités
et traitements pour la famille ; | ||||||||
| Section 3- Guide pratique pour la détermination du taux d'incapacité | ||||||||
| On donne ci-après un certain nombre de repères qui, pour chacun d'entre eux, constitue un critère suffisant pour l'attribution d'un taux compris dans la fourchette considérée. Toutefois, ces listes ne sont pas exhaustives et il revient à la commission d'apprécier par analogie avec ces exemples les cas particuliers qui lui sont soumis. | ||||||||
| I. - Troubles légers entraînant une gêne, quelques interdits rares ou des troubles subjectifs sans incapacité réelle constatée dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne (taux de 0 à 15 %) (...) | ||||||||
II. - Troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %) (...) | ||||||||
| (...)
Rééducations n'entravant pas l'intégration scolaire, la vie
sociale, familiale, professionnelle. Régime permettant la prise de repas à l'extérieur, moyennant des aménagements importants, ou l'apport de nutriments mais ne nécessitant pas la présence d'un tiers. Pour les enfants, contraintes éducatives restant en rapport avec l'âge, ou limitées à une aide supplémentaire compatible avec la vie familiale, sociale ou professionnelle habituelle de la personne qui l'apporte. | ||||||||
| III. - Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle (taux 50 à 75 %) | ||||||||
| (...) Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale. | ||||||||
| (...) Régime ne permettant la prise de repas à l'extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d'âge sans déficience. | ||||||||
IV.
- Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie
individuelle | ||||||||
Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l'autonomie individuelle de la personne telle que définie à l'introduction du présent guide barème. (...). | ||||||||
| Seul un état végétatif chronique autorise l'attribution d'un taux d'incapacité de 100 %. | ||||||||
Mise à jour : 19/11/07
| ||||||||